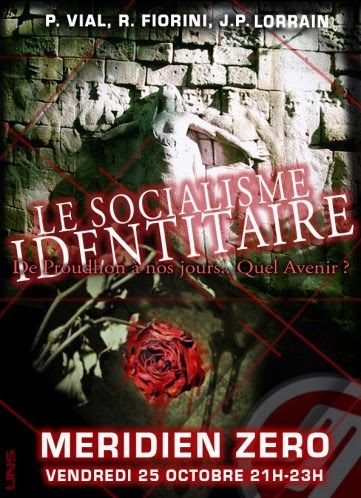Texte de Dominique Venner :
"Remarques liminaires : Je reproduis ici intégralement un article fondateur que j’avais publié dans Le Figaro du 1er février 1999 sous le titre : « La souveraineté n’est pas l’identité ». Cet article s’inscrivait dans le débat provoqué par le Traité d’Amsterdam et les discussions au sujet de la future Union européenne. Mon intention était de libérer les esprits à l’égard de l’histoire jacobine et « statocentrée » (ayant l’État pour explication), qui a toujours été enseignée en France sous l’influence d’un Etat centralisateur exceptionnellement puissant. Cette histoire exclusivement centrée sur l’Etat a pratiqué une sorte de négation du peuple français et de la nation charnelle que j’entendais réhabiliter. Cet article provoqua quelques vives polémiques dans les milieux les plus attachés à l’idée de souveraineté, favorisant une réflexion nouvelle sur l’identité nationale. Je le reproduis tel qu’il fut publié à l’époque.
Un vent de panique souffle dans nos ultimes chaumières. La France survivra-t-elle à l’Euro, au traité d’Amsterdam, à la conjuration des eurocrates, à l’an 2000 ? Les abandons de souveraineté sont-ils des abandons d’identité ? Sur ces vraies questions, sur le défi de la construction européenne, les historiens sont restés étrangement silencieux. Pourtant, s’il est un domaine où l’histoire peut éclairer l’avenir, c’est bien celui de l’identité française au sein de l’Europe.
Contrairement à la nation allemande qui a vécu sans Etat unitaire pendant six siècles, de 1250 à 1871, la France n’a pas l’expérience d’une telle interruption. L’Etat unitaire s’y est maintenu sans discontinuer dans la même période. De là une relation causale inscrite dans nos esprits entre souveraineté et identité. C’est même devenu une sorte de dogme, entretenu par l’enseignement jacobin de l’histoire, que la nation française serait une création de l’Etat et que, privée de ce dernier, elle serait en péril de mort et de dissolution.
Si cela était, une telle nation ne vaudrait pas cher. Mais c’est faux. Certes, personne ne contestera que l’Etat, royal ou républicain, a édifié le cadre politique et administratif de la nation. En revanche, il n’est pour rien dans la formation de sa substance. Il n’est pas le créateur du peuple français ni la source de son identité. Et cela, l’histoire le démontre. Mais cette vérité est si contraire à nos idées reçues, qu’il faut quelques développements.
Reportons-nous aux origines, au Serment de Strasbourg, publiquement prêté en février 842 par Charles le Chauve et Louis le Germanique, petits-fils de Charlemagne. Le texte faisant foi fut rédigé en roman (français ancien) et en tudesque. Il s’agit du plus ancien document connu attestant une séparation linguistique entre barons francs germanophones et francophones issus de la même souche. Le Serment de Strasbourg est en quelque sorte l’acte de naissance officiel des Français et des Allemands avant la France et l’Allemagne. En ce IXe siècle, sans qu’il n’y eut jamais d’Etat national, deux peuples et deux cultures différentes sont déjà attestés par l’émergence mystérieuse de deux langues distinctes.
Avançons dans le temps. Dès les XIe et XIIe siècle, les preuves abondent d’une spécificité française rayonnante. A l’époque, l’Etat centralisé est encore inexistant, la petite cour des petits rois de ce temps n’est pour rien dans la Chanson de Roland, ni dans Tristan et Iseult, ni dans le Lancelot de Chrestien de Troyes, monuments primordiaux d’une francité bien enracinée dans le socle européen. Le rôle de l’Etat est tout aussi absent dans l’affirmation du style roman et dans le foisonnement, aux siècles suivants, de l’admirable architecture profane des châteaux, des villes et des maisons rurales, négligée par l’historiographie savante jusqu’à André Chastel.
Qu’est-ce qu’un peuple, qu’est-ce qu’une idendité? Au XIIe siècle, l’illustre Suger, abbé de Saint-Denis et conseiller de Louis VII, répond à sa façon : “Nous sommes Français de France, nés d’un même ventre.” Cinq siècles plus tard, le grammairien Vaugelas, chargé en 1639 de diriger la rédaction du Grand dictionnaire de l’Académie propose cette définition : “Peuple ne signifie pas plèbe, mais communauté représentée fidèlement par sa noblesse.”
Moins que l’Etat, le facteur déterminant de la naissance d’une nation, est l’existence d’un “peuple-noyau”, homogène, nombreux, actif, “représenté par sa noblesse”, à partir duquel se déploient une langue et un style qui, de proche en proche s’étendent aux peuples voisins et apparentés. Tel fut le destin historique du “peuple-noyau” d’île de France, Picardie et Neustrie, à forte composition franque. Les rois capétiens en firent le socle de leurs ambitions. Qu’est devenu, sous la sèche férule de l’Etat, ce “peuple-noyau”, peuple de Bouvines et de tant d’autres exploits, jadis si vigoureux ?
C’est à lui que nous devons notre langue et sa force intérieure longtemps inentamée. Emile Littré l’a souligné dans son Histoire de la langue française. Il y montrait quelle vitalité puissante et proprement originelle a permis le passage d’un bas-latin celtisé et germanisé au roman puis au français.
Avant que d’être ennoblie par la littérature, la langue a surgi du peuple. Montaigne le savait bien qui écrivait : “J’aimerais mieux que mon fils apprît aux tavernes à parler qu’aux écoles d’éloquence… Puissé-je ne me servir que des mots qui servent aux Halles de Paris!” Ronsard ne disait pas autre chose en assignant cette condition à l’adoption de mots nouveaux : “qu’ils soient moulés et façonnés sur un patron déjà reçu du peuple“. Un patron qu’Etiemble, au XXe siècle, appellera joliment le “gosier populaire“. Encore faut-il naturellement qu’il y ait un peuple, c’est à dire des communautés vivantes et enracinées, tout ce que l’Etat centraliste n’aime pas et a toujours combattu.
L’Etat a sa logique qui n’est pas celle de la nation vivante. Celle-ci n’a rien à craindre des abandons de souveraineté, pour cette bonne raison que la souveraineté ne se confond pas avec l’identité. S’il en fallait encore une preuve, l’histoire du Québec nous l’apporterait éloquemment. Depuis le traité de Paris en 1763, les Français du Canada ont été totalement abandonnés par l’Etat royal. Isolés dans un univers hostile et sous une souveraineté étrangère, non seulement ils n’ont pas disparu, mais ils se sont multipliés, conservant leur langue ancestrale et leurs usages, luttant victorieusement contre l’hégémonie linguistique anglo-saxonne. Là est l’identité, dans la fidélité à soi-même et nulle part ailleurs.
Note
On pourrait ajouter qu’au XIVe siècle plusieurs grands fiefs souvent d’origine carolingienne et de langue française échappaient à l’État royal, mais pas à l’identité française : Grande Bourgogne, Guyenne, Flandre française, Lorraine des ducs, Franche-Comté et Savoie, sans compter la Bretagne indépendante."
Source